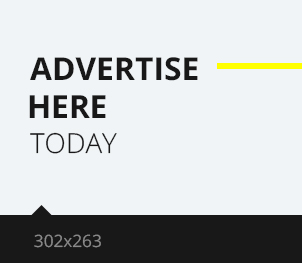Salim Hallali disait « Lmout Kayna wla3dab 3lach » (« La mort existe, mais pourquoi souffrir »). Constat douloureux pour les souffrants comme pour leur entourage. On ne meurt qu’une fois certes, mais on peut endurer la douleur et le supplice à différents degrés. On est là, debout, et puis on s’effondre. Le cœur est bien en place, seulement d’autres organes ou des membres lâchent et c’est le début d’une nouvelle existence teintée d’aléas et d’apprentissage d’un mode de vie inédit. Dur est ce changement quasi-radical, troublant est ce basculement dans l’inconnu. On est subitement confronté à des codes de résistance, à de nouvelles marges de subsistance. Et la vie continue, amputant l’être de quelques rêves qui trouvent refuge derrière la vallée de l’oubli. Mais on s’accroche et on rêvasse, on sourit aux autres pour leur rappeler la chance qu’ils ont à continuer de jouir de ce que la vie initiale leur offre. Avec dignité. On peut s’arracher les cheveux parce qu’on les a, on peut se flageller le crâne parce qu’on est dépourvu de poils, on peut donner des coups de poing sur la table parce que les mains continuent à prolonger les bras, mais on ne peut plus fourvoyer le sol parce qu’un pied manque. Et ce pied devient psychiquement une force. Une force que le reste du corps ne comprend pas puisqu’il ne fait plus partie de son tout, livré à tout être physiquement « normalement » né. Le pied, gangrené, est arraché à jamais. Son souvenir prend plus de poids que son existence conjuguée désormais au passé, un passé lourd d’un présent étourdissant. Ce texte, ainsi conté, circule dans mes veines, puisque c’est de ma femme et mère de mon unique fille qu’il est question. Belle est sa résistance. Elle se relève au pied levé.