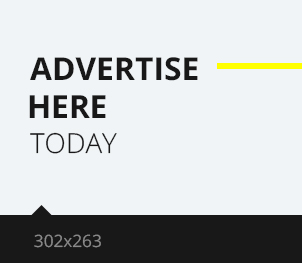L’industrie cinématographique indienne a rapporté l’an dernier 1,5 milliard de dollars au box office, selon le cabinet de conseil Ormax Media, mais s’exporte peu dans les pays occidentaux.
Et le pays n’accorde que peu de soutien au cinéma indépendant présenté dans les grands festivals internationaux, comme Cannes.
Jeudi, une cinéaste indienne, Payal Kapadia, fait son entrée dans la course à la Palme d’or, ce qui n’était pas arrivé depuis 30 ans, avec « All we imagine as light », un portrait poétique de deux femmes qui ont quitté leur région d’origine pour travailler comme infirmières à Mumbaï.
Mais le film a eu besoin du soutien de la France et d’autres investisseurs internationaux pour être produit.
« L’industrie indienne est assez autonome, donc beaucoup de cinéastes ne ressentent même pas le besoin d’envoyer leur travail aux festivals, » a déclaré Payal Kapadia, 38 ans, à l’AFP à Cannes.
« Mais si vous voulez tourner un petit film, pas tellement axé sur la narration, ou qui ne fonctionne pas dans le système, il est difficile de trouver des financements. Le système français (de soutien au cinéma) m’a vraiment beaucoup aidée, » a-t-elle ajouté.
A une époque, l’Inde était fréquemment représentée à Cannes. Chetan Anand a été l’un des lauréats de la première Palme d’or en 1946 avec « Neecha Nagar » et plusieurs films ont ensuite été en compétition, dont ceux du réalisateur Satyajit Ray.
Les choses ont ensuite ralenti, la précédente présence indienne dans la course à la Palme d’or remontant à « Destinée » (« Swaham » en VO) de Shaji N. Karun, en 1994.
Le film de Payal Kapadia n’est pas le seul long-métrage indien présenté cette année, dans l’ensemble des sélections cannoises.
« Sister Midnight » (Quinzaine des cinéastes) parle d’un mariage arrangé dans une petite ville, et « The Shameless » (Un Certain regard) une travailleuse du sexe qui fuit un bordel de Delhi après avoir poignardé un policier.
« Santosh », également à Un Certain regard, a reçu des critiques élogieuses. Cette histoire d’une femme policière confrontée à la misogynie, à la corruption et à la brutalité dans une petite ville indienne a été saluée comme un « polar captivant et puissamment féministe » (Time Out) et « une leçon de subtilité » (IndieWire).
La réalisatrice de « Santosh », Sandhya Suri, a déclaré à l’AFP qu’il s’agissait peut-être d’une histoire « difficile et complexe », mais que sa première préoccupation était pour « les policiers qu'(elle) connaît – comment ils vont regarder cela ».
« C’est un film qui devrait sembler réaliste pour un public indien et pas seulement être un film tourné vers l’Occident, » a-t-elle déclaré.
Les vedettes de « Santosh », Shahana Goswami et Sunita Rajwar, dont la relation complexe porte le film, ont affirmé que l’Inde comptait de nombreux grands cinéastes, mais qu’il leur était souvent difficile de trouver une plateforme de diffusion.
« En Inde, le cinéma est principalement perçu comme un divertissement, donc il suit les lois du marché. Les films indépendants sont très difficiles à réaliser même s’ils sont peu coûteux, » a déclaré Shahana Goswami.
Son rêve ? Rassembler et organiser toutes les petites entreprises indépendantes. Payal Kapadia, elle, espère que l’Inde pourra suivre l’exemple français et faire profiter les films d’auteur d’une partie des bénéfices des blockbusters.
« Si un petit pourcentage était mis dans un fonds qui allait aux films indépendants, cela aiderait tellement de gens, » a-t-elle espéré.