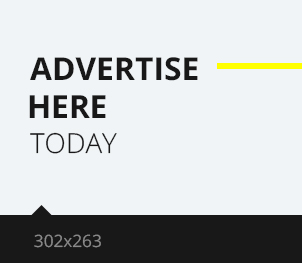Libé: vous avez choisi le thème de « la résistance » pour le Forum mondial pour la paix en Normandie. Comment peut-on définir le côté social comme approche principale dans l’analyse des relations internationales ?
Bertrand Badie : Autrefois, la dimension sociale était totalement absente, et elle était d’un certain point de vue doublement absente. D’une part, parce que le couple guerre et paix, on ne s’intéressait qu’à la guerre et la paix était considérée tout simplement comme une non-guerre. C’est-à-dire que la paix était pensée en termes militaires, excluant la dimension sociale. Et le deuxième élément déterminant, c’est que dans l’histoire de la guerre, notamment la guerre européenne telle qu’elle est apparue à la fin du Moyen Âge et tous les siècles qui ont précédé celui-ci, était un phénomène extérieur à la société. Au début, la société n’était touchée par la guerre que d’une manière indirecte à travers les razzias et les épidémies. Après, notamment avec la Révolution française, la guerre s’est rapprochée de la société, avec la levée en masse et les fameux soldats de l’An II en France qui ont projeté sur toute l’Europe une idéologie nouvelle. On a vu peu à peu l’opinion publique entrer dans cette guerre. A partir de la guerre de Crimée dans les années 1850, la société a été de plus en plus impliquée, avec la multiplication des entrepreneurs sociaux et des ONG ayant un rôle important.
On n’atteignait jamais la société dans son cœur, mais depuis 1945, il y a eu un bouleversement de la donne internationale. Les acteurs sociaux et les sociétés sont devenus des acteurs à part entière du jeu guerrier. Les déclencheurs ont été la décolonisation, qui a montré que des sociétés pouvaient vaincre des Etats fortement militarisés, la dépolarisation avec la chute de l’URSS, qui a redistribué les cartes et favorisé l’essor de conflits dans la périphérie, et enfin, la mondialisation, avec une plus grande connexion de chaque individu aux enjeux internationaux. La mondialisation a également renforcé le rôle de l’économie et des interdépendances économiques, contribuant à socialiser la question de la guerre et de la paix. Les grands enjeux sociaux mondiaux, tels que l’insécurité alimentaire, climatique, sanitaire et économique, ont modifié en profondeur l’agenda international, de moins en moins dominé par les questions stratégiques classiques et de plus en plus par les questions sociales impliquant l’ensemble de l’humanité.
Cela signifie que le côté social explique parfois les décisions des décideurs, notamment dans le contexte des élections ?
Oui, c’est l’expression du poids grandissant des opinions publiques sur les politiques étrangères. Cela est vrai dans les démocraties, mais aussi dans les régimes autoritaires. Même dans ces régimes, les dictateurs savent qu’ils devront composer avec l’évolution des sociétés et des opinions publiques, comme l’ont montré les Printemps arabes, les événements en Iran en 2022, ou les mouvements en Chine en 1989 et, plus récemment, lors du rejet du confinement par la population chinoise.
Tout cela s’inscrit dans l’agenda et est lié aux politiques étrangères, mais aussi à la décision de choisir la guerre ou la paix.
Dans le même sens, un intervenant a dit lors de la séance d’ouverture du forum que le choc de l’immigration fait reculer les démocraties. La peur de l’immigration fait-elle reculer la démocratie elle-même?
Je plaiderai l’inverse. La classe politique fait le pari de gagner les élections en plaçant la question migratoire de façon mensongère sur le marché électoral. Effectivement, il est très facile de se constituer une clientèle électorale en faisant valoir que les valeurs de chacun sont imputables aux étrangers. Stigmatiser l’étranger peut rapporter gros sur le marché électoral, pervertissant ainsi le jeu électoral et démocratique par une utilisation frauduleuse de l’argument migratoire. Nous sommes dans un monde mondialisé où la migration va se banaliser de plus en plus, et le migrant est devenu l’avenir du monde.
La peur de l’immigration en Occident et en France est-elle due aux médias ou aux acteurs politiques? Par exemple, d’un côté, les patrons réclament de la main-d’œuvre, et de l’autre, les politiques sont paralysés entre les besoins de l’économie et la peur de leur électorat hostile à l’immigration.
Moi, je crois que tout ceci est fondamentalement imputable à l’incapacité de s’adapter aux données nouvelles de notre époque. Nous sommes dans la mondialisation, un contexte différent des rivalités souverainistes et interétatiques d’autrefois. On a peur de s’adapter à la mondialisation, on a peur d’avoir un nouveau regard sur la migration qui peut être une opportunité dans un monde de mobilité et d’interdépendance. Une migration bien conçue et bien gérée peut être bénéfique pour tous. Cependant, la pensée n’évolue pas, et on traite la migration principalement par la répression, créant ainsi clandestinité, bonheur des passeurs et propagande raciste.
A partir de cela, la responsabilité des acteurs politiques est de montrer les opportunités nouvelles, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Les personnes issues de cultures différentes se rencontrant diminuent les tensions interculturelles. Si la culture de l’autre est traitée de manière stigmatisante et répressive, cela attise la conflictualité interculturelle, comme on le voit en France avec la stigmatisation des musulmans. Il faut repenser tout cela, mais rares sont les acteurs politiques qui ont le courage de le faire. Les médias sont souvent complices de cette facilité, et nous sommes confrontés à la situation tragique d’aujourd’hui.
A propos de la situation de la France en Afrique, on a vu récemment des coups d’Etat dans plusieurs pays, notamment en Afrique subsaharienne. Comment expliquez-vous ce recul de la présence de la France et cette hostilité de la population locale envers sa politique dans la région ?
Malheureusement, la France, à l’instar de toutes les anciennes puissances coloniales, n’a pas su sortir de la séquence coloniale. Elle a fait de la décolonisation une façon dangereuse de recomposer les liens de dépendance d’autrefois sous une forme nouvelle. Cela s’est traduit par un échec et une inefficacité totale, une crise persistante de gouvernance des Etats post-coloniaux, une clientélisation abusive et un développement incertain. Tout cela a généré un comportement de frustration chez les populations africaines qui sont devenues mondialisées et ne comprennent pas que l’Afrique est mondialisée comme les autres continents. La France a eu du mal à s’adapter à cette nouvelle réalité, peinant à appréhender l’autre dans une perspective postcoloniale et persistant à évaluer autrui selon ses propres normes. Les relations franco-marocaines se dégradent. Cette détérioration se manifeste même au Moyen-Orient, où la France connaît des échecs en termes de politique étrangère, notamment au Liban.
La crise avec la France a touché ces dernières années le Maghreb notamment le Maroc. Les relations franco-marocaines étaient stables depuis la fin du protectorat en 1956, malgré quelques crises mineures. Est-ce la première fois que nous faisons face à une crise majeure?
Il faut être honnête, ce sont des relations qui ont connu des hauts et des bas. L’affaire Ben Barka a créé des tensions, mais les relations se sont rétablies notamment à l’époque du président Valéry Giscard d’Estaing. Ensuite, elles se sont plus ou moins maintenues avec quelques secousses, mais pour l’essentiel, elles ont perduré. Cependant, depuis quelques années, elles se dégradent. Certains éléments appartiennent à l’agenda marocain, notamment l’affaire du Sahara, mais il y a aussi des maladresses, notamment en matière de visa. Il est contradictoire de plaider pour une forte présence marocaine en France, justifiant ainsi des relations spéciales, tout en refusant des visas qui nuisent aux familles et perturbent les échanges habituels. Il est impossible de maintenir des relations privilégiées tout en normalisant la délivrance des visas, comme si ceux accordés aux Marocains étaient comparables à ceux destinés aux Zambiens ou aux Indonésiens.
La politique des visas a touché le public francophone qui avait l’habitude de visiter la France pour des séminaires, des conférences, tourisme, etc, impactant ainsi l’élite proche de la France. Est-ce que cela signifie un changement dans la politique de la France envers le Maroc ?
Les politiques étrangères sont souvent une combinaison d’affaires de structure et de personnes. Il y a cet imbroglio entre le maintien de relations spéciales postcoloniales et la réalité des nouvelles dynamiques. Cependant, il y a aussi une dimension personnelle. Bien que je ne sois pas un spécialiste de la question, il est dit que les relations personnelles entre le Roi du Maroc et le président de la France ne sont pas au beau fixe. Des incidents diplomatiques, comme celui lors du tremblement de terre dans la région d’Al Haouz, où la Grande-Bretagne et l’Espagne ont été privilégiées en Europe au détriment de la France, sont significatifs de quelque chose.
Comme vous l’avez dit lors de la conférence, le monde ne sera plus comme avant. Peut-on appliquer cela aux relations de la France avec l’Afrique ?
Absolument, je crois fermement que l’on peut rétablir et établir. Ce qui me rend optimiste, c’est que je vais souvent en Afrique, et dès que le débat commence, il y a un esprit de fraternité qui émerge, surtout chez cette nouvelle génération d’Africains qui ont un projet pour l’Afrique, un projet qui leur est propre. La chance pour l’Afrique, c’est de réaliser son projet, pas celui d’un autre. En participant à la réalisation de ce projet, la France peut jouer un rôle, tout comme les amis maghrébins ou africains qui ont participé à l’industrialisation de la France.
Caen : Entretien réalisé par Youssef Lahlali