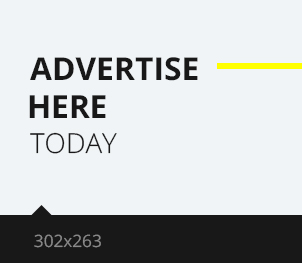Un nouveau rapport du Policy Center for the New South (PCNS) retrace les origines de la guerre froide que mène l’Algérie face au Maroc à partir des déboires internes du régime algérien. Décryptage.
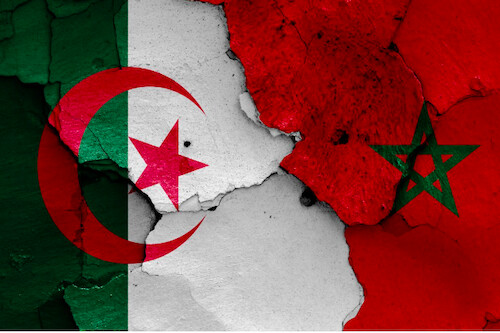
Nombreux sont les experts qui ont tenté d’appréhender les origines de la rupture actuelle entre l’Algérie et le Maroc, laquelle relève parfois de l’irrationnel, tellement le régime algérien fait des choix contre-nature.
La nature de cette relation est si singulière que parfois la raison ne suffit pas pour en déceler les causes. Pourtant, on dispose d’un repère temporel : 2019, l’année où le basculement s’est accentué avec l’arrivée du président Abdelmajid Tebboune, après un Hirak populaire qui a failli ébranler tous les fondements du régime militaire. Depuis lors, celui-ci, avec l’arrivée du général Saïd Chengriha à la tête de l’Armée, s’est efforcé de rejouer la carte de l’ennemi extérieur pour fédérer le peuple algérien contre “la menace extérieure”, d’où l’escalade à laquelle s’est livré Alger depuis 2019 et qui a abouti ensuite à la rupture unilatérale des relations diplomatiques deux années plus tard sous des prétextes fallacieux.
La crise d’un régime à bout de souffle !
Ceci est le corollaire d’une crise interne que le régime algérien tente de transformer en conflit extérieur. D’où cette guerre froide dont un nouveau papier du Policy Center for the New South explique les dessous. Signé par le chercheur Abdessalam Jaldi, ce document de 18 pages livre un diagnostic lucide et circonstancié sur la mutation du régime algérien après le Hirak et ses conséquences sur sa politique étrangère. Il s’agit d’une grille de lecture différente visant à appréhender la crise algéro-marocaine à partir de la crise politique que traverse l’Algérie depuis 2019.
Radicalisation du régime après le Hirak
L’auteur rappelle que face aux revendications d’une deuxième République civile exprimée lors du Hirak, le régime a opté pour le maintien du statu quo avec des semblants de réformes limitées. Une façon de contourner le Hirak par un simulacre d’ouverture. Résultat des courses : un président aux ordres, propulsé par les généraux au pouvoir à l’issue d’une élection factice largement boycottée. A cela s’ajoutent une constitution taillée sur mesure et une répression d’une ampleur inédite contre les meneurs du Hirak et les voix dissidentes. Boualem Sansal en fait partie !
L’auteur résume on ne peut plus clairement cette stratégie de contournement. “Le rôle prédominant de l’armée et l’absence de réelles avancées démocratiques montrent que le pouvoir algérien reste fortement ancré dans des logiques de contrôle et de gestion de crise, plutôt que d’ouverture véritable au dialogue et à la pluralité”, conclut-il.
Cela dit, le Hirak a été étouffé aussi bien par des semblants de réformes que par la force. “Le chemin vers une Algérie nouvelle et plus démocratique semble semé d’embûches”, souligne la même source. Preuve en est que les explosions de colère populaire surgissent de temps à autre à l’image du mouvement #ManishRadi qui a failli ressusciter le Hirak.
Un résultat évident de “l’érosion des libertés individuelles et publiques”, comme l’explique Abdessalam Jaldi, qui revient sur les multiples contraintes qui étouffent les droits civiques, notamment le droit de rassemblement, ultra verrouillé. “La société civile algérienne se trouve confrontée à un environnement particulièrement contraignant, où les libertés d’association et d’expression sont étroitement surveillées”, lit-on dans le document.
Cela n’est pas étonnant puisque le régime s’efforce de verrouiller autant qu’il peut l’espace public pour s’assurer que le Hirak ne ressuscite jamais. C’est le syndrome de tout Etat militaire qui privilégie toujours la logique martiale au sommet du pouvoir. Raison pour laquelle la nouvelle Constitution de 2020 permet de déroger aux droits et libertés garantis afin de préserver les vagues principes de l’ordre public.
Le Hirak a poussé le régime à “présidentialiser” plus que jamais le pouvoir à travers la réforme constitutionnelle. Le président a été gratifié de pouvoirs étendus tandis que le Parlement a vu sa marge de manœuvre réduite. “Il s’agissait d’une Constitution imposée d’en haut, et non pas rédigée par ou en concertation avec une Assemblée constituante élue incarnant la souveraineté populaire”, rappelle l’auteur.
Repli sur soi
En dépit des promesses d’ouverture sur l’opposition, le régime s’est replié sur lui-même. En témoignent le maintien des vieux faucons de la politique dans le gouvernement de Nabil Nadir Larbaoui et la militarisation de l’appareil d’Etat avec le décret du 27 juin, qui permet aux officiers de l’armée de tenir des «fonctions supérieures de l’État, des secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté et d’intérêts vitaux».
En parallèle, les ministres civils sont strictement écartés du Haut Conseil de défense, l’un des organes les plus sensibles de l’Etat. Un revers majeur à ceux qui aspirent à une république plus civile. “Les questions sérieuses sont visiblement l’apanage des seuls galonnés”, ironise Abdessalam Jaldi.
En quête d’ennemi extérieur
Ce marasme de politique intérieure est si étouffant que le régime cherche à respirer ailleurs. D’où la volonté du “grand retour sur la scène internationale”, ostensiblement affichée du président Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. Alger a voué sa manne gazière pour y parvenir en profitant de la hausse des cours de l’énergie suite à la guerre en Ukraine.
Une stratégie vouée à l’échec puisque Alger n’a obtenu que des revers dont le rejet de son adhésion aux BRICS est révélateur. “Ceci a poussé le régime à basculer vers plus de réalisme en s’ouvrant plus sur l’Occident, notamment les Etats-Unis, qu’il est en train de flatter actuellement.
Dans ce sillage, le régime algérien a tout fait pour provoquer une escalade avec le Maroc. Une des rares cartes dont disposait le régime pour regagner le soutien de l’opinion algérienne, qui succombe facilement à la propagande anti-marocaine ininterrompue. Soutien maximal au Polisario, rupture des relations bilatérales en 2021, suspension des liaisons aériennes, coupure des livraisons de gaz, réarmement d’une ampleur inédite, menaces de guerre… Le régime algérien a eu recours à tous les stratagèmes possibles pour provoquer un conflit ouvert avec le Maroc, qui a fait preuve d’une retenue proverbiale. Entre-temps, l’Algérie cherche à tout prix à isoler le Royaume dans son voisinage, à commencer par le Maghreb. D’où ses tentatives inlassables de ressusciter l’intégration maghrébine, sans le Maroc. Là, le rapport souligne que “la crise des relations algéro-marocaines façonne la politique maghrébine d’Alger”. “Cette initiative, dont Alger assure le rôle de pivot, vise à asseoir l’hégémonie d’Alger au Maghreb tout en excluant délibérément le Maroc”, poursuit l’auteur. Selon lui, à travers cette stratégie d’isolement, l’Algérie cherche à entraîner une “Tunisie vassalisée” et une Libye instable dans sa croisade contre le Maroc dans le but d’asseoir le leadership algérien sur le Maghreb. L’auteur insiste à cet égard sur la volonté délibérée d’Alger de “prolonger sa guerre froide avec Rabat”. Pour l’instant, les Sommets trilatéraux avec la Tunisie et la Libye n’ont pas donné l’effet escompté, sauf des effets d’annonce. Cela est dû à des causes structurelles dont l’auteur cite le manque de complémentarité entre les trois pays concernés qui souffrent tous d’une instabilité politique chronique.
L’Opinion Maroc – Actualité et Infos au Maroc et dans le monde.Read More