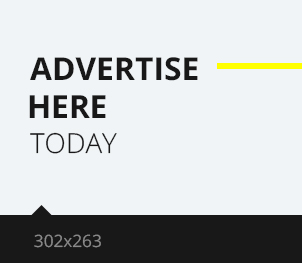Les droits des femmes au Maroc ont connu des avancées majeures, notamment avec la réforme de la Moudawana en 2004. Mais des inégalités persistent, freinant leur pleine émancipation. Vingt ans plus tard, Sa Majesté le Roi Mohammed VI engage une nouvelle réforme du Code de la famille pour renforcer l’égalité et garantir aux femmes des droits mieux adaptés aux réalités actuelles.

L’un des tournants majeurs de cette dynamique a été la réforme de la Moudawana en 2004. Le Code de la famille marocain, profondément revisité, a marqué un progrès historique en matière de droits des femmes. Jusque-là, les dispositions légales plaçaient les femmes dans une situation d’infériorité juridique manifeste, soumises à des règles patriarcales qui limitaient leur autonomie et leurs perspectives. Dès son discours d’ouverture du Parlement en 2003, le Souverain a affiché une volonté ferme de transformer en profondeur ce cadre légal, malgré les résistances de certains courants conservateurs.
La réforme adoptée en 2004 a introduit des changements fondamentaux. Elle a d’abord modifié la notion de tutelle matrimoniale, supprimant l’obligation pour les femmes d’obtenir l’accord d’un tuteur pour se marier. Cette avancée a renforcé leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions concernant leur propre vie. Ensuite, l’âge légal du mariage a été relevé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, contre 15 ans auparavant, bien que certaines dérogations judiciaires aient encore permis des mariages précoces.
Autre avancée majeure, la réforme a instauré la coresponsabilité des conjoints dans la gestion du foyer, mettant fin au principe du « chef de famille » exclusivement masculin. La polygamie, bien que toujours autorisée, a été drastiquement encadrée, nécessitant l’accord de la première épouse ainsi que l’autorisation d’un juge qui ne l’accorde que sous des conditions strictes. De même, le droit au divorce a été étendu aux femmes, qui peuvent désormais l’initier et en obtenir la reconnaissance par la justice sans être contraintes de prouver des fautes graves.
Par ailleurs, si ces réformes ont marqué une avancée significative, elles montrent aujourd’hui leurs limites. Les dérogations permettant encore le mariage des mineures sont un sujet de préoccupation majeur, et les inégalités dans l’héritage, bien qu’inscrites dans un cadre religieux, sont de plus en plus contestées par des mouvements féministes qui plaident pour une refonte du système successoral.
C’est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi a pris une nouvelle initiative historique en octobre 2023 en appelant à une deuxième réforme de la Moudawana. Par une lettre adressée au Chef du gouvernement, il a ordonné l’activation d’un chantier de révision du Code de la famille, en vue d’apporter des ajustements nécessaires à la consolidation des droits des femmes. Cette démarche intervient après plusieurs années de débats et de plaidoyers menés par des associations de défense des droits des femmes et des juristes, qui alertaient sur les insuffisances de la réforme de 2004.
Le projet de réforme actuellement en cours de discussion prévoit plusieurs évolutions majeures. D’abord, une restriction encore plus stricte de la polygamie est envisagée, avec l’objectif de la rendre quasi-inapplicable dans les faits. Ensuite, le droit de garde des enfants en cas de divorce pourrait être renforcé en faveur des mères, en leur garantissant un cadre juridique plus protecteur. Un autre chantier sensible concerne la reconnaissance des droits économiques des femmes mariées : la nouvelle Moudawana pourrait introduire des dispositions garantissant un partage plus équitable des biens acquis durant le mariage, une mesure fortement attendue par les militantes féministes.
Par ailleurs, au-delà du cadre juridique, l’émancipation des femmes marocaines passe aussi par leur intégration économique et leur autonomisation financière. Sur ce plan, des efforts ont été déployés pour favoriser l’accès des femmes au marché du travail et aux postes de responsabilité. Le taux d’activité des femmes demeure cependant relativement faible, se situant autour de 20 % selon les dernières statistiques du Haut-Commissariat au Plan, bien en deçà de la moyenne régionale.
Cette situation s’explique par divers facteurs, notamment le poids des normes culturelles, l’absence de dispositifs de soutien adaptés, et une ségrégation professionnelle qui cantonne encore trop souvent les femmes à des secteurs précaires et mal rémunérés.
Dans cette optique, plusieurs initiatives ont été mises en place pour encourager l’entrepreneuriat féminin et améliorer l’accès des femmes aux financements. Des programmes comme « Intilaka » ou « Forsa » visent à soutenir les porteurs de projets, avec une attention particulière accordée aux femmes entrepreneures. De même, des réformes ont été engagées pour améliorer les conditions de travail des femmes, notamment en renforçant les congés de maternité et en encourageant la mise en place de structures de garde pour les enfants.
L’égalité des sexes passe aussi par l’éducation, et sur ce plan, des progrès considérables ont été réalisés. La scolarisation des filles a connu une nette amélioration, et l’accès des jeunes femmes aux études supérieures s’est accru de manière significative. Toutefois, les disparités persistent entre les milieux urbains et ruraux, où le taux d’abandon scolaire des filles reste préoccupant.
Le Maroc se trouve donc à un tournant décisif dans son engagement en faveur des droits des femmes. La réforme de la Moudawana, annoncée pour 2024, constitue une opportunité historique d’aller plus loin dans la consolidation des acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’égalité. Mais au-delà des textes, c’est une transformation profonde des mentalités et des pratiques sociales qui doit accompagner ces évolutions, afin que l’égalité entre les sexes devienne une réalité tangible dans toutes les sphères de la société. L’aboutissement de ce chantier sera déterminant pour l’avenir du Maroc et pour son ambition de bâtir une nation moderne, inclusive et équitable.
L’Opinion Maroc – Actualité et Infos au Maroc et dans le monde.Read More